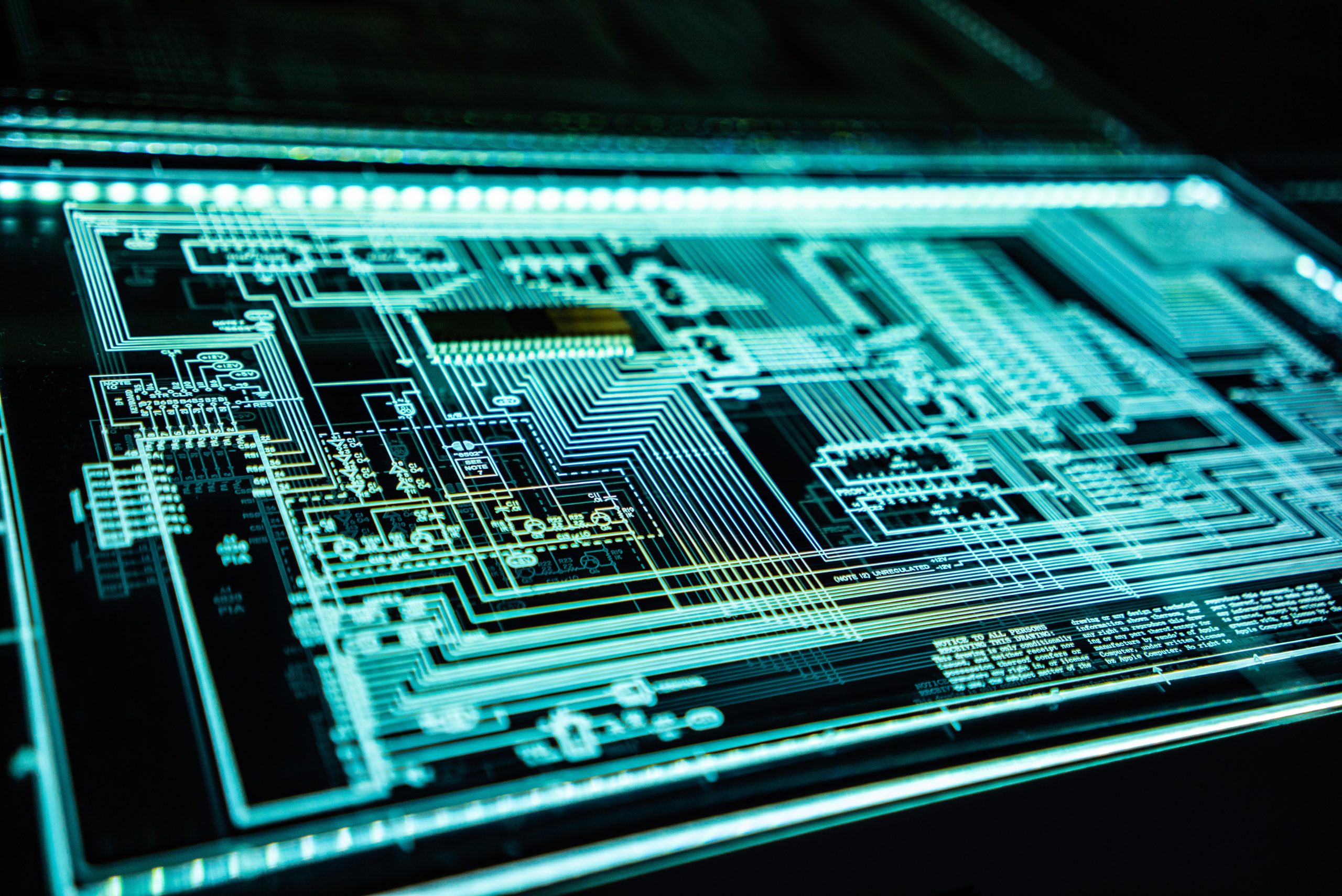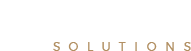AVOCATS
L’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique.
Albert Einstein
Un groupement d’avocats dans un monde de création et d’innovation
HIRO Avocats est né de la volonté d’offrir aux acteurs de la création et de l’innovation une assistance personnalisée au fait des évolutions technologiques et du foisonnement des idées.
Au service des dirigeants d’entreprises, des inventeurs de concepts et de technologies, des artistes en tous domaines et des acteurs engagés dans le monde de demain, HIRO Avocats offre une expérience et un savoir-faire alliant la maîtrise du droit à la compréhension des enjeux économiques, en plus d’un engagement total destiné à assurer à ses clients un traitement judiciaire aussi favorable que possible.
La dimension humaine de son activité demeure au cœur de son action, convaincu que le succès n’est possible sans une relation forte entre le justiciable et son avocat.
L’action d’HIRO Avocats a été distinguée par le magazine LE POINT pour sa pratique en Propriété intellectuelle, Propriété industrielle, Nouvelles technologies, Droit commercial, Droit pénal général et Droit pénal des affaires. Le Magazine DECIDEURS JURIDIQUES l’a distingué pour sa pratique en Droit pénal fiscal et en Droit pénal du travail.
HIRO Avocats a également été récompensé d’un Trophée d’argent décerné par les SOMMETS DU DROIT – LEADERS LEAGUE dans la catégorie « Firme entrepreneuriale de moins de 5 ans ».
Publications
Nos dernières actualités
No posts were found for provided query parameters.
Publications
Nos dernières actualités
Contact
Envoyez-nous un message
Notre Cabinet
Paris
Tel : +33 (0)1.86.95.91.91
Fax : +33 (0)1.83.62.12.73
contact@hiro-avocats.com
Métro & Tram
- Rue de la Pompe (ligne 9)
- Avenue Henri Martin (ligne C)
- Indigo Place Victor Hugo)
- Rue de Passy
Contact
Envoyez-nous un message
Nous contacter
29 bis, rue Pierre Demours – 75017 PARIS
Tel : +33 (0)1.75.95.16.99
Fax : +33 (0)1.83.62.12.73
Métro & Tram
- Charles-de-Gaulle Etoile (Métro lignes 1,2 et 6 ; RER A)
- Ternes (Métro ligne 2)
Parking public
- Parking Etoile Pereire
Métro & Tram
- Rue de la Pompe (ligne 9)
- Avenue Henri Martin (ligne C)
Parking public
- Indigo Place Victor Hugo
- Rue de Passy